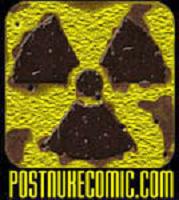Résumé critique : Qu'est-ce que le nazisme? de Ian Kershaw
D'origine britannique et sommité du Troisième Reich mondialement reconnue, c'est cependant en tant que spécialiste du Moyen Âge que Ian Kershaw débute sa carrière d'historien. En 1975, il obtient un poste comme professeur d'histoire contemporaine et délaisse définitivement sa fonction de médiéviste lorsqu'il est invité par Martin Broszat – grand historien allemand de la période nazie – à participer à un projet d'histoire sociale relatif au nazisme. Après avoir publié en 1983 Popular opinions and political dissent in the Third Reich. Bavaria, 1933-1945 et qui amène un regard nouveau sur l'opinion publique durant le régime hitlérien, I. Kershaw termine en 1985 la première édition de l'œuvre retenue pour ce résumé critique, soit Qu'est-ce que le nazisme? Problèmes et perspectives d'interprétation.
Le présent travail comporte trois volets : d'abord, les intentions et la thèse de Ian Kershaw sont exposées, lesquelles sont suivies d'un résumé de chacun des chapitres du livre et pour terminer, d'une évaluation de la nouveauté de l'ouvrage et de la cohérence de l'ensemble de l'œuvre.
Dans un premier temps, présentons les grandes lignes des intentions de l'auteur. Comme l'énonce le titre de l'ouvrage, Ian Kershaw s'applique à dégager les problèmes fondamentaux d'interprétation du IIIe Reich, à exposer de façon précise les aspects controversés, à présenter les divergences de point de vue entre les historiens et finalement à évaluer leurs positions. De plus, cet ouvrage ne traite que des thèmes jugés les plus importants par l'auteur et se limitant tous à la période hitlérienne, ce qui fait que, par exemple, l'évaluation d'un Sonderweg allemand (c'est-à-dire la « voie particulière ») ou le lien entre le « grand capital » et le nazisme ne sont abordés que succinctement. En ce qui a trait à l'édition française en particulier, Kershaw espère apporter une contribution à l'historiographie en langue française sur la période nazie puisque le nombre de travaux dans ce domaine n'y abonde pas.
À maintes reprises dans son ouvrage, Ian Kershaw avance des indices qui nous renseignent sur sa thèse, cependant un passage la formule explicitement : « Composantes essentielles d'une explication du IIIe Reich, « intention » et « structure » doivent faire l'objet d'une synthèse, plutôt que d'être mises en opposition. Il semble que les « intentions » de Hitler aient surtout contribué à créer le climat général dans lequel la dynamique du régime pouvait se transformer en une prophétie autoréalisée. » [1] Ce passage est aussi cité dans l'ouvrage L'État hitlérien et la société allemande : 1933-1945 de Norbert Frei qui déclare que de nombreux auteurs, et non les moindres, ont souligné la complémentarité de l'approche « intentionnaliste » et celle « structuraliste ». Qui plus est, Kershaw fait remarquer lors d'un entretien : « En affirmant que je n'ai pas une démarche hitléro-centriste, je n'enlève rien à l'importance du Führer. Mais je pense qu'il fut lui-même emporté par des forces, par ce processus, plus qu'il ne le contrôla. » [2]
Par ses propos, l'auteur laisse sous-entendre qu'il penche davantage du côté « structuraliste » et qu'il rejette de fait toutes les analyses « hitléro-centristes ». Même s'il déclare vouloir établir le pont entre les intentions et les structures et malgré le fait qu'il ne nie pas que l'Holocauste, sans Hitler, ne se serait probablement pas produit, Ian Kershaw est d'avis qu'avec le temps, le IIIe Reich se développa progressivement en un régime « polycratique » où le Führer perdit peu à peu le contrôle.
Il nous apparaît pertinent à présent de résumer chacun des chapitres de l'ouvrage en y relevant l'idée principale. Présenté dès le premier chapitre, l'objectif poursuivi par Ian Kershaw est celui de proposer une explication du nazisme en y dégageant les principaux problèmes d'interprétation qui sont liés entre autres, à la récente historikerstreit (« querelle des historiens »). La dimension historico-philosophique divise désormais les historiens entre partisans d'une interprétation « structuralo-fonctionnaliste » et ceux adoptant l'approche « intentionnaliste ». En ce qui a trait à l'aspect politico-idéologique, il implique les divergences d'explication du nazisme, déterminées notamment par le partage de l'Allemagne en deux zones durant la Guerre froide. Finalement, Kershaw examine la dimension morale, soit la difficulté d'analyser le Troisième Reich sans porter un jugement moral sur la compréhension des événements, particulièrement l'Holocauste. C'est cette dimension qui a suscité les plus vifs débats lors de la historikerstreit.
Doit-on analyser le nazisme comme une spécificité allemande ou bien plutôt comme une faiblesse du système capitaliste existant alors en Allemagne? C'est en quelque sorte l'idée principale du second chapitre. Ian Kershaw présente sommairement les concepts de totalitarisme et de fascisme selon ou non une interprétation marxiste, évalue par la suite le nazisme en fonction de ces concepts ou d'un phénomène unique. L'auteur termine ce chapitre par une conclusion personnelle : le nazisme est un phénomène unique en son genre, mais cette spécificité allemande ne doit pas être uniquement attribuée à la personnalité du Führer.
Ian Kershaw expose au cours du troisième chapitre les diverses interprétations portant sur le lien entre capitalisme et nazisme, c'est-à-dire quelle fut l'influence de l'industrie allemande sur la politique du régime nazi. Selon Kershaw, il faut prendre en considération la nature « polycratique » du régime afin de replacer le « grand capital » dans l'ensemble complexe de la structure du pouvoir du IIIe Reich et de rejeter les analyses accordant soit une importance extrême aux facteurs économiques, soit une primauté excessive du politique sur l'économie.
Dans le chapitre qui suit, Kershaw évalue tour à tour l'interprétation accordant la primauté au « facteur Hitler », à savoir celle privilégiant l'intentionnalité du Führer, de même que celle qui, diamétralement opposée, est qualifiée de « structuraliste », de « fonctionnaliste » ou encore de façon péjorative de « révisionniste ». Pour chacune de ces interprétations, il en analyse l'évolution et expose la prise de position adoptée par les spécialistes de la période. L'auteur conclut finalement qu'Hitler ne fut ni le « maître du IIIe Reich » ni un « dictateur faible » et les intentions de ce dernier, tout comme les structures du régime, ne doivent pas être mises en opposition, mais plutôt utilisées conjointement.
Après avoir analysé le rôle de Hitler vis-à-vis des structures du régime, Kershaw présente dans le cinquième chapitre les interprétations divergentes – liées à l'opposition « intentions» et « structures » – quant au rôle du Führer dans le cheminement qui aboutit à l'Holocauste. Encore une fois, Ian Kershaw adopte une position médiane entre une interprétation « hitlériste » concevant l'extermination des Juifs comme un plan longuement mûri et une interprétation « structuraliste » insistant sur l'improvisation des décisions d'Hitler. Toutefois, sans nier les intentions du Führer, Kershaw est d'avis que ce n'est pas banaliser l'atrocité d'Auschwitz que de vouloir comprendre la façon dont le pouvoir charismatique d'Hitler réussit à radicaliser les structures du régime en y imprégnant sa rage envers les Juifs.
Ian Kershaw poursuit en utilisant le même procédé que dans les chapitres précédents, c'est-à-dire celui d'exposer les interprétations pour ensuite les évaluer. L'auteur en arrive à une conclusion semblable, à savoir que si le rôle d'Hitler fut plus important en politique étrangère qu'en politique intérieure ou encore en politique anti-juive et qu'on peut davantage songer à interpréter un « programme » du Führer, il n'en demeure pas moins qu'une interprétation satisfaisante doit autant considérer les intentions d'Hitler que les facteurs internes et externes du IIIe Reich et ce, même en politique étrangère.
Se détachant du débat structuralisme/intentionnalisme, Ian Kershaw présente dans son septième chapitre trois interprétations différentes de l'évaluation du IIIe Reich. D'abord, les historiens marxistes – pas uniquement, mais dans une forte proportion – refusent l'idée d'une « révolution sociale » qu'aurait engendré l'établissement du IIIe Reich. Des historiens libéraux, comme Ralf Dahrendorf ou David Schoenbaum, soutiennent que les changements sur les structures de l'État furent si profonds que l'idée d'une « révolution sociale » leur paraît pertinente. Quant à la troisième interprétation, elle insiste sur le fait que certains changements furent modernisateurs et d'autres réactionnaires et que, par conséquent, on ne peut qualifier le nazisme de « révolution sociale ». Kershaw rejette lui aussi cette idée de révolution, toutefois il est d'avis que, même s'il fut négatif, le nazisme entraîna plusieurs conséquences sur la société allemande qu'on ne peut cependant qualifier de forces modernisatrices, mais de « progrès » ou de « modernité » dans un sens neutre puisque probablement n'importe quel autre régime aurait produit ces progrès, l'Allemagne étant déjà une société capitaliste très développée.
L'histoire de la résistance au nazisme fut d'abord interprétée différemment en Allemagne de l'Ouest qu'en Allemagne de l'Est. L'auteur évalue diverses interprétations du concept de la résistance à partir de toute réaction quotidienne face au nazisme, la résistance organisée par les élites (approche « fondamentaliste »), celle aussi du citoyen ordinaire (approche « sociétale ») et il termine ce chapitre en se demandant s'il y eut réellement une « résistance sans le peuple » comme l'a énoncé pour la première fois Hans Mommsen. Ian Kershaw répond par l'affirmative, c'est-à-dire que malgré une certaine opposition, le régime hitlérien reçut un soutien populaire plus important en comparaison avec plusieurs régimes autoritaires, ce qu'il explique par l'idée que si on pouvait contester plusieurs choses dans l'Allemagne nazie, on se félicitait aussi des nombreux changements.
Le neuvième chapitre n'apparaît pas dans la première édition de 1985 puisqu'il traite de la « querelle des historiens » de 1986 où l'idée d'une « historicisation » du IIIe Reich est débattue, soit celle de déterminer s'il est possible de traiter la période nazie comme n'importe quelle autre époque de l'histoire. Kershaw est d'avis qu'il faut appliquer des méthodes historiques dites « normales » à l'histoire sociale et politique du IIIe Reich, même si un détachement absolu par rapport à cette période est difficile puisqu'elle appartient encore au passé récent.
Au chapitre suivant, Ian Kershaw présente les essais de révision de la période nazie par trois éminents historiens, soit respectivement Ernst Nolte, Andreas Hillgruber et Michael Stürmer. Nolte tente d'insérer l'Holocauste dans la série de génocides que connut le XXe siècle sans lui accorder une spécificité, Hillgruber s'intéresse à la poursuite du combat sans relâche même lorsque les défaites s'accumulaient et Stürmer étudie la nature de l'identité historique allemande. Selon Kershaw, même si ces théories révisionnistes ne reçurent pas un très grand appui lors de la historikerstreit et qu'il leur reproche de ne pas respecter la spécificité du IIIe Reich, il est légitime que de nouvelles interprétations du passé nazi se développent en autant qu'elles servent à améliorer la connaissance historique de cette période.
À la suite de la réunification de l'Allemagne en 1990, apparut un nouveau courant historiographique, d'où l'intérêt de ce chapitre qui ne faisait pas partie des premières éditions. Kershaw y expose les nouvelles interprétations du nazisme par rapport à l'identité nationale, à la modernisation et au stalinisme. Il termine ce onzième chapitre et, du même coup, cet ouvrage en posant une question qu'il croit fondamentale à toute analyse du IIIe Reich : comment le nazisme et l'Holocauste furent-ils possibles dans une société moderne et industrialisée? Encore de nos jours, c'est la dimension morale qui soulève la plus grande polémique et Ian Kershaw est d'avis qu'il faut laisser de côté l'idée de l'impossibilité d'une compréhension d'Auschwitz et des politiques antihumanistes du Troisième Reich pour aborder cette période en utilisant conjointement les phénomènes de « normalité » et de génocide dans une perspective intégrant autant l'approche « intentionnaliste » que celle « structuraliste ».
Dans la troisième partie du présent travail, les nouveautés de l'ouvrage qui ont suscité notre attention sont évoquées et la cohérence de l'ensemble de l'œuvre est aussi brièvement analysée. En ce qui a trait à la nouveauté de cet ouvrage de Kershaw, c'est avant tout celle de ne pas donner de réponses définitives aux questions fondamentales soulevées, mais plutôt de permettre au lecteur de se forger une opinion informée sur le régime nazi. À chacun des chapitres, l'auteur présente les divers courants historiographiques qui ont façonné la compréhension du IIIe Reich et il expose aussi les divergences d'interprétation entre d'éminents spécialistes de cette période. En outre, Kershaw ne prétend pas répondre à toutes les questions et il souligne que certains aspects mériteraient une meilleure analyse advenant le cas où il décidait de récrire son ouvrage au complet. Un autre point intéressant à relever est son souci de prendre en considération le développement de la recherche historique sur le IIIe Reich lors de la réédition de l'ouvrage. Pour la première édition en langue française, par exemple, il a rédigé à nouveau certains passages du chapitre « Hitler et l'Holocauste » à la suite des suggestions de Philippe Burrin, un auteur d'origine suisse. Finalement, il faut souligner que la manière dont est bâtie la plupart des chapitres en facilite la compréhension.
Ainsi, Kershaw présente souvent en premier les interprétations de divers spécialistes sur le sujet pour ensuite évaluer les questions soulevées. De plus, il rejette rarement une théorie dans son entier et si cela se présente, il explique la raison pour laquelle elle n'est plus valable aujourd'hui, compte tenu du développement historiographique. Comme nous l'avons souligné précédemment, Ian Kershaw adopte une approche médiane et il rejette de ce fait l'idée de prendre totalement position dans le débat structuralisme / intentionnalisme. S'agit-il alors d'un défaut de l'œuvre ou d'un manque de cohérence? C'est l'aspect dont traite le chapitre suivant.
Lors de la première lecture du livre, l'harmonie générale nous semble sans équivoque, c'est-à-dire que le lien entre les diverses idées est mené de façon logique et l'ouvrage est écrit dans un style clair et concis. Selon notre première impression, il est effectivement de propos de lui accorder ces qualificatifs, auxquels il faudrait rajouter notamment un enchaînement cohérent entre les différents chapitres, une explication simple mais précise de certaines subtilités (comme le concept de Resitenz, introduit par Martin Broszat) et le développement cohérent des intentions de l'auteur énoncées en début de livre. Cependant, par suite d'une analyse plus poussée, la position « entre deux eaux » de l'auteur nous cause quelque irritation. À trop vouloir concilier les deux approches, celle « intentionnaliste » et celle « structuraliste », l'œuvre semble perdre un peu de sa cohérence puisque l'on a rarement une réponse précise et définitive de l'auteur aux questions fondamentales présentées. Le reproche que l'on peut porter à cet ouvrage est celui de ne pas toujours s'en tenir à sa thèse principale, celle d'une synthèse des approches, et d'être à l'occasion davantage structuraliste même s'il n'est pas toujours facile de déceler si l'auteur adopte réellement un point de vue précis sur un aspect à l'étude. Il nous apparaît tout de même difficile de reprocher à Ian Kershaw sa position plutôt conciliante ou médiane à partir du moment où notre réflexion sur les divers aspects traités par l'auteur nous porte à croire qu'il s'agit de la meilleure façon d'aborder l'étude du IIIe Reich.
En conclusion de ce résumé critique et après avoir apprécié l'ouvrage selon trois éléments, soit les intentions et la thèse de l'auteur, un abrégé des chapitres et la présentation de ce qui nous semble être la nouveauté du livre et l'évaluation de sa cohérence, il nous est possible d'avancer qu'au delà d'une simple lecture, une analyse plus en profondeur s'impose à ceux qui désirent perfectionner leurs connaissances sur le Troisième Reich. Cet ouvrage répond aux principales questions fondamentales de la période nazie tout en laissant au lecteur le soin de se forger une opinion personnelle puisqu'il dispose d'un vaste éventail d'interprétations divergentes sur le sujet, d'une imposante bibliographie d'ouvrages récents et pour chaque chapitre, d'un renvoi de notes comportant souvent des débats historiographiques. Finalement, une analyse historiographique de cette œuvre de Ian Kershaw mérite d'être rédigée, notamment pour tenter de comprendre les raisons qui ont amené l'éminent historien à adopter cette perspective particulière.
Bibliographie
Frei, Norbert. L'État hitlérien et la société allemande : 1933-1945. Paris, Éditions du Seuil, 1994. 368 pages. (Coll. « XXe siècle »).
Kershaw, Ian. Popular opinions and political dissent in the Third Reich. Bavaria, 1933-1945. Oxford, Clarendon Press, 1983. 425 pages.
Kershaw Ian. Qu'est-ce que le nazisme? Problèmes et perspectives d'interprétation. Paris, Gallimard, 1997 [1985]. 536 pages.
Roman, Thomas. « Eurozine – article – Entretien : Ian Kershaw ». http://www.eurozine.com/article/2002-10-24-roman-fr.html. octobre 2002. Consulté le 2 mars 2004.
[1] Ian Kershaw, Qu'est-ce que le nazisme? Problèmes et perspectives d'interprétation, Paris, Gallimard, 1997 [1985], page. 162.
[2] Thomas Roman, « Eurozine – article – Entretien : Ian Kershaw », http://www.eurozine.com/article/2002-10-24-roman-fr.html octobre 2002, Consulté le 2 mars 2004.