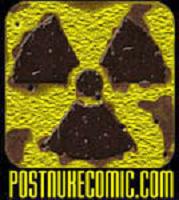Une bibliothèque
Romans
BARICCO, Alessandro - Soie
BARICCO, Alessandro - Novecento : pianiste
BEAUVOIR, Simone de - Tous les hommes sont mortels
BECKETT, Samuel - Endgame suivi de Act Without Words
BLIXEN, Karen - L'éternelle histoire
BROWN, Dan - Anges et Démons
BURGESS, Anthony - L'orange mécanique
CAMUS, Albert - Caligula suivi de Le malentendu
CAMUS, Albert - L'étranger
CAMUS, Albert - L'exil et le royaume
CAMUS, Albert - La chute
CAMUS, Albert - La peste
COELHO, Paulo - L'Alchimiste
COELHO, Paulo - Véronika décide de mourir
COURTEMANCHE, Gil - Un dimanche à la piscine à Kigali
DOSTOÏEVSKI, Fedor Mikhaïlovitch - Crime et Châtiment
DOSTOÏEVSKI, Fedor Mikhaïlovitch - Les Frères Karamazov
DUGAIN, Marc - La malédiction d'Edgar
GARCIA, Cristina - Les soeurs Agüero
GARCIA, Cristina - Rêver en cubain
GODBOUT, Jacques - Salut Galarneau!
HAFFNER, Sébastien - Histoire d'un Allemand
HÉBERT, Anne - Les chambres de bois
HEMINGWAY, Ernest - For Whom the Bell Tolls
HUXLEY, Aldous - Le meilleur des mondes
JARDIN, Alexandre - Le Petit Sauvage
KAFKA, Franz - La métamorphose suivi de Description d'un combat
KAFKA, Franz - Le château
KAFKA, Franz - Le Procès
KUNDERA, Milan - L'ignorance
KUNDERA, Milan - L'insoutenable légèreté de l'être
LITTELL, Jonathan - Les Bienveillantes
MAUPASSANT, Guy de - 12 contes réalistes
MÉRIMÉE, Prosper - Carmen
ORWELL, George - 1984
ORWELL, George - La ferme des animaux
PEARL, Matthew - Le cercle de Dante
PENNAC, Daniel - Au bonheur des ogres
POULIN, Jacques - Volkswagen blues
PRÉVERT, Jacques - Paroles
ROY, Gabrielle - La Montagne secrète
SARTRE, Jean-Paul - La nausée
SCHMITT, Eric-Emmanuel - L'Évangile selon Pilate
SCHMITT, Eric-Emmanuel - La part de l'autre
SCHMITT, Eric-Emmanuel - La Secte des égoïstes
SKARMETA, Antonio - Une ardente patience
STEINBECK, John - Des souris et des hommes
TASCHEREAU, Ghislain - L'Inspecteur Specteur et la planète Nète
TOLKIEN, John R. Reuel - Le Seigneur des anneaux, tome 1 : La communauté de l'anneau
TOLKIEN, John R. Reuel - Le Seigneur des anneaux, tome 2 : Les deux tours
TOLKIEN, John R. Reuel - Le Seigneur des anneaux, tome 3 : Le retour du roi
VARGAFTIG, Bernard - La poésie des romantiques
VIAN, Boris - L'écume des jours
VIAN, Boris - L'arrache-coeur
VOLTAIRE, (François Marie Arouet) - Candide ou l'Optimisme
ZOLA, Émile - Germinal
Ouvrages généraux (histoire et science politique)
AMBROSI, Christian et al. - La France de 1870 à nos jours
BALARD, Michel et al. - Le Moyen Âge en Occident
BÉLANGER, André-J et Vincent Lemieux - Introduction à l'analyse politique
BERNARD, André - La vie politique au Québec et au Canada
CHASSAIGNE, Philippe - Histoire de l'Angleterre
COUTURIER, Jacques Paul - Un passé composé : le Canada de 1850 à nos jours
DICKINSON, John-A et Brian Young - Brève histoire socio-économique du Québec
DUROSELLE, Jean-Baptiste - L'Europe de 1815 à nos jours
GOUGEON, Jacques-Pierre - L'Allemagne dans les relations internationales de 1890 a nos jours
LEBRUN, François - L'Europe et le monde : Du 16e au 18e siècle
PETIT, Paul et André Laronde - Précis d'histoire ancienne
QUERMONNE, Jean-Louis - Les régimes politiques occidentaux
VANDEN, Harry E. et Gary Prevos - Politics of Latin America : The Power Game
VINCENT, Bernard - Histoire des États-Unis
ZINN, Howard - Une Histoire populaire des États-Unis de 1492 a nos jours
Monographies historiques
BLOCH, Marc - Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien
BLOCH, Marc - L'étrange défaite
DÔLE, Robert - Le cauchemar américain
DOSSE, Francois - L'histoire ou le temps réfléchi
FRIED, Richard M. - Nightmare in Red: The McCarthy Era in Perspective
FUKUYAMA, Francis - La Fin de l'histoire et le dernier homme
HOBSBAWM, Eric John - L'Âge des extrêmes : Histoire du court XXe siècle, 1914-1991
HUSSON, Édouard - Comprendre Hitler et la Shoah : Les Historiens de la République fédérale d'Allemagne et l'identité allemande depuis 1949
KASPI, André - Les Américains, tome 1 : Naissance et essor des États-Unis, 1607-1945
KASPI, André - Les Américains, tome 2 : Les États-Unis de 1945 à nos jours
KASPI, André - Les États-unis d'aujourd'hui : Mal connus, mal aimés, mal compris
KENNEDY, Paul - Naissance et déclin des grandes puissances : Transformations économiques et conflits militaires entre 1500 et 2000
KERSHAW, Ian - Hitler : Essai sur le charisme en politique
KERSHAW, Ian - Hitler, tome 1 : 1889-1936
KERSHAW, Ian - Hitler, tome 2 : 1936-1945
KERSHAW, Ian - Qu'est-ce que le nazisme? Problèmes et perspectives d'interprétation
LEUCHTENBURG, William E. - The Perils of Prosperity, 1914-1932
ROUILLARD, Jacques - Le syndicalisme québecois : Deux siècles d'histoire
SCHRECKER, Ellen - The Age of McCarthyism : A Brief History with Documents
SHEEHAN, Neil - L'Innocence perdue
TOCQUEVILLE, Alexis de - De la Démocratie en Amérique, tome 1
TOCQUEVILLE, Alexis de - De la Démocratie en Amérique, tome 2
TODD, EMMANUEL - Après l'Empire : Essai sur la décomposition du système américain
TOINET, Marie-France - La chasse aux sorcières, le Maccarthysme, 1947-1957
Monographies politiques
ARON, Raymond - Démocratie et totalitarisme
CHOMSKY, Noam - La fabrique de l'Opinion publique - La Politique économique des médias américains
CHOMSKY, Noam - Le nouvel humanisme militaire
CHOSSUDOVSKY, Michel - La mondialisation de la pauvreté
DAVID, Charles-Philippe - Au sein de la Maison-Blanche : La formulation de la politique étrangère des États-Unis
DEBLOCK, Christian, dir. - L’ALENA : Le libre-échange en défaut
GILL, Louis - Le néolibéralisme
HOGAN, Michael J. et Thomas G. Paterson - Explaining the History of American Foreign Relations
KESSELMAN, Mark et al. - European Politics in Transition
PELLETIER, Réjean et al. - Le parlementarisme canadien
WEBER, Max - Le savant et le politique
Essais philosophiques
ALAIN, (Émile Chartier) - Propos sur le bonheur
BOISSINOT, Christian et al. - L'Art de vivre. Les stoïciens et Épicure
CAMUS, Albert - L'homme révolté
CAMUS, Albert - Le mythe de Sisyphe
GADAMER, Hans-Georg - Nietzsche : L'Antipode, le drame de Zarathoustra
MACHIAVEL, Nicolas - Le Prince
MORE, Thomas - L'Utopie
NIETZSCHE, Friedrich - Ainsi parlait Zarathoustra
NIETZSCHE, Friedrich - L'Antéchrist suivi de Ecce Homo
PASCAL, Blaise - Pensées
Autres (dont autobiographies)
DALLAIRE, Roméo - J'ai serré la main du diable : La faillite de l'humanité au Rwanda
DALLAIRE, Yvon - Homme et fier de l'être
GLADWELL, Malcolm - Blink : The Power of Thinking Without Thinking
LESTER, Normand - Le Livre Noir du Canada Anglais, Tome 1
LEVI, Primo - Si c'est un homme
THOREAU, Henry David - Désobéir